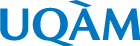L’évolution du PAMT et ses impacts sur les employés et les entreprises : une nouvelle étude
Entre le Régime de qualification né en 1993 sous l’égide de la Société québécoise de développement de la main-d’œuvre et le Programme d’apprentissage en milieu de travail mis sur pied par la Commission des partenaires du marché du travail en 2001, près de vingt ans se sont écoulés. Quelle évolution a connu ce dispositif du réseau de l’emploi? Quels sont ses effets sur les employés et les entreprises?
À partir des résultats d’une enquête récente (2009) menée par le Comité sectoriel des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine1) nous voyons que les clientèles ont évolué au fil des années entraînant de nouveaux usages. De dispositif de qualification complémentaire aux diplômes de la formation professionnelle qu’il était au début des années 90, il est devenu – et le devient de plus en plus avec la nouvelle Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre – un système de certification autonome s’inscrivant en cela dans la tendance internationale favorisant le développement de tels systèmes pour la formation de la main-d’oeuvre tout au long de la vie active.
Les résultats de l’enquête du Comité sectoriel montrent que les effets du dispositif de qualification sont considérables, entre autres, sur la qualité du travail, la polyvalence et l’autonomie des employés, mais aussi et c’est là un phénomène fort intéressant, sur le développement professionnel continue renforçant ainsi le statut de système de certification qu’il est en train d’acquérir. Pour les autres résultats, consultez la version intégrale de l’enquête sur le site du Comité sectoriel.
L’enquête portant sur les usages et les effets du PAMT, il était impératif de sélectionner des entreprises qui connaissent le programme et qui en ont une bonne expérience. Sans trop entrer dans les détails méthodologiques, disons que c’est la raison pour laquelle un échantillon stratifié fut constitué à partir de ces critères : signature d’ententes récentes,signature d’ententes récurrentes et bon volume d’ententes.
Au terme du processus, 277 entreprises ont été retenues pour l’échantillon et sur ce nombre, 146 entreprises ont participé à l’enquête. Ces 146 entreprises ont signé 25% des ententes et formé 40% des apprentis en ébénisterie, peinture-finition, rembourrage et assemblage de portes et fenêtres depuis que ces programmes existent. Par conséquent, nous avons là, une bonne source d’information pour réfléchir sur les usages et les effets du dispositif.
La clientèle des programmes ébénisterie, peinture-finition, assemblage de portes et fenêtres et rembourrage est variée : diplômés de la formation professionnelle et non-diplômés, travailleurs expérimentés ou pas dans les métiers visés par les programmes, travailleurs détenant ou pas de l’ancienneté dans les entreprises.
Profil des apprentis au moment de leur inscription en ébénisterie, peinture-finition, assemblage de portes et fenêtres et rembourrage (1997 à 2009)
| Diplômés de la formation professionnelle | Oui 22% | |
| Non 78% | ||
| Expérience sur le métier visé par le programme | Oui 40% | Plus de 2 ans : 18%De 1 an à 2 ans : 22% |
| Non 60% | Moins de 1 an : 28% | |
| Aucune expérience : 32% | ||
| Ancienneté dans l’entreprise | Oui 36% | Plus de 1 an : 36% |
| Non 64% | De 3 mois à 1 an : 39% | |
| Moins de 3 mois : 25% |
Dans l’ensemble, les entreprises estiment que le PAMT améliore la qualité du travail (82%), la polyvalence (80%), l’autonomie (75%) et la productivité (63%) des employés qui y participent.
Les effets sur l’organisation sont aussi jugés importants. Les entreprises constatent une amélioration de la souplesse de l’organisation du travail due à la polyvalence des employés (75%), de la qualité des produits fabriqués (72%), de la planification et de l’organisation de la formation (66%), de la diminution des accidents de travail (68%) et de la productivité de l’entreprise (63%).
En outre, les employés qui terminent un programme se voient confier des nouvelles tâches (92,1%) et pour l’essentiel, il s’agit de tâches plus diversifiées (90,1%), de tâches plus complexes (76%) et mieux rémunérées (73,4%). Le changement de poste ou d’emploi et/ou l’obtention d’une promotion touchent une proportion moindre d’entre eux (43,5%).
Ajoutons à ces effets que pour plus de 90% des entreprises, le PAMT et avant lui le RQ, ont été les premiers programmes de formation interne qu’elles ont utilisés – en spécifiant bien sûr que c’est plus souvent le cas des plus petites entreprises puisque chez les 50 et plus cette proportion baisse à 58%.
Pour terminer sur les effets, soulignons que les entreprises sont aussi nombreuses (80%) à estimer que le dispositif a contribué à améliorer les compétences de formateurs de leurs compagnons.
Sur les clientèles
À l’origine conçu pour les diplômés de la formation professionnelle, le dispositif s’adresse aujourd’hui et ce, majoritairement, à des travailleurs qui n’ont pas de formation.
À l’origine conçu pour des jeunes sans expérience nouvellement en emploi, le dispositif s’adresse aujourd’hui aussi, et tout autant, aux travailleurs expérimentés et aux travailleurs qui ont de l’ancienneté dans l’entreprise. D’ailleurs, cette évolution explique le malaise ressenti dans le réseau et ce, depuis plusieurs années, concernant l’appellation « apprenti » pour désigner la clientèle du PAMT.
Ajoutons à ces constats que, depuis 2007, la composition de la clientèle est appelée à s’étendre aux travailleurs sans emploi, en vertu de l’article 25,7 de la nouvelle Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Soit dit en passant, cet article n’est pas sans rappeler l’article 40 de la Loi de modernisation sociale promulguée en 2002 en France. En effet, cet article 25,7 – à l’instar de l’article 40 – donne un droit aux travailleurs en emploi et sans emploi de se voir reconnaître leurs compétences dès lors qu’ils exercent un métier couvert par une norme professionnelle.
Sur les usages
Au fil des années, l’évolution des clientèles du PAMT a entraîné une évolution des usages du dispositif du réseau de l’emploi. Pour bien saisir cette évolution, nous proposons les notions de reconnaissance-parcours et de reconnaissance-constat. La reconnaissance-parcours s’inscrit dans un processus d’apprentissage ou de formation et son objectif est l’acquisition de compétences. À l’inverse, la reconnaissance-constat ne s’inscrit pas dans un parcours d’apprentissage ou de formation. L’objectif visé est stricto sensu l’obtention d’une certification.
Cette typologie provient des chercheurs du CEREQ2)qui l’ont développée pour rendre compte des nouvelles possibilités offertes par la Loi de modernisation sociale en France qui permet aux citoyens de se voir octroyer, via la « Validation des acquis de l’expérience » (VAE), la totalité d’une qualification qu’il s’agisse d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification professionnelle.
Au début de son existence, le dispositif de qualification du réseau de l’emploi est utilisé essentiellement pour former une main-d’œuvre nouvelle. Progressivement, cependant, les employeurs y ont recours pour former des travailleurs à leur emploi, qui plus est, des travailleurs qui ont déjà une expérience des métiers visés par les programmes. Dès lors, des pratiques de reconnaissance-parcours émergent pour moduler la durée des ententes. C’est ainsi que les agents d’Emploi-Québec en région ont développé des procédures et des outils de reconnaissance des compétences qui, bien que variant selon la région et l’agent, reposent toutes sur le jugement du compagnon et, parfois, de l’apprenti. Le CSMOFMI a bien décrit ces pratiques de reconnaissance-parcours qu’il nomme évaluation préliminaire.
L’évaluation préliminaire consiste à déterminer sommairement le niveau de qualification de l’apprenti par rapport à chacun des éléments de compétences du carnet en vue de déterminer ses besoins de formation, d’établir un plan d’apprentissage et d’en évaluer la durée. Pour ce faire, le compagnon dispose du guide du compagnon ou d’un tiré à part qui reproduit les éléments de compétence du carnet. Sur une échelle comportant de 3 à 5 niveaux (selon la région et l’agent d’Emploi-Québec), il coche celui qui selon lui correspond au niveau de maîtrise de l’apprenti. Il n’y a ni observation ni autre forme d’évaluation. Parfois, parallèlement au jugement du compagnon, l’apprenti procède à sa propre évaluation et les deux se concertent par la suite pour en arriver à un consensus3).
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et de l’article dont nous avons fait mention précédemment, ces pratiques de reconnaissance-parcours vont paraître insuffisantes. Le CSMOFMI exprime bien la situation :
À la rigueur, ce type d’évaluation (l’évaluation préliminaire) peut servir à la reconnaissance des compétences d’un travailleur qui œuvre au sein de l’entreprise depuis longtemps [ce qui signifie que pour un travailleur expérimenté, elle peut convenir]. Le compagnon, chargé de l’évaluation, sait ce dont ce travailleur est capable pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs années. Pas besoin de le voir accomplir les tâches pour attester sa maîtrise des compétences du carnet, même si cette évaluation demeure subjective. Toutefois, dans le cas d’un employé que le compagnon connaît peu ou pas, il est impossible de procéder de cette façon, du moins si le but de l’exercice est la seule reconnaissance des compétences4).
Si bien qu’en vertu de cet article 25,7, la Commission des partenaires du marché du travail, via la Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle, a demandé aux comités sectoriels de main-d’œuvre qui ont des normes professionnelles d’élaborer un processus d’évaluation et de reconnaissance des compétences pour les travailleurs de leur secteur respectif qu’ils soient en emploi ou sans emploi.
Et depuis, les comités sectoriels se sont attelés à la tâche entrant dans une phase intensive d’innovation qui en amènent certains à recourir à d’autres stratégies que le compagnonnage qui jusqu’à maintenant prédominait largement dans le dispositif de qualification professionnelle du réseau de l’emploi. Encore là, le CSMOFMI résume bien la situation :
Étant donné qu’on ne peut reconnaître les compétences d’un travailleur sans emploi aux mêmes conditions qu’un travailleur qui participe au PAMT (c’est-à-dire observation en milieu de travail sur une période plus ou moins longue, reconnaissance des compétences allant de pair avec leur développement ou possibilité d’acquérir les compétences manquantes), deux solutions s’offrent à nous :
- la mise sur pied d’un programme de stages ou de séjours en entreprises basé sur les outils du PAMT ;
- l’élaboration d’un outil d’évaluation et l’établissement d’une stratégie de reconnaissance des compétences hors du milieu de travail.
Ce qui nouveau dans le dispositif de qualification professionnelle du réseau de l’emploi, et ce vers quoi il tend actuellement, c’est le développement de procédures et d’outils permettant la reconnaissance-constat. Afin de cerner l’existence de ce nouvel usage et son potentiel de développement, une question portait sur l’intérêt des entreprises à inscrire au programme des employés expérimentés à des fins de reconnaissance de compétences uniquement. Seize entreprises, soit 11% de l’échantillon, ont répondu qu’elles le faisaient déjà. Il est intéressant de constater que l’usage reconnaissance-constat est en émergence.
Sur les effets
Constatons d’abord que les effets du dispositif du réseau de l’emploi sont remarquables dans ce milieu industriel et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Toutefois, deux phénomènes retiennent notre attention plus particulièrement : l’effet sur la polyvalence et l’effet sur la progression-mobilité professionnelle.
L’effet polyvalence
Les entreprises estiment que le programme contribue à l’amélioration de la polyvalence des employés et ce, dans une proportion de 80%. Lorsqu’il est question d’un effet sur l’organisation, 75% jugent que le programme contribue à l’amélioration de la souplesse de l’organisation du travail. Ces effets perçus sont validés par un effet réel sur la trajectoire professionnelle puisque 90% des employés se voient confier des tâches plus diversifiées à la sortie d’un programme.
L’effet polyvalence est une bonne nouvelle pour ce milieu industriel aux prises avec une main-d’œuvre peu scolarisée à l’embauche – nombreux étant ceux qui ne détiennent ni DEP, ni DES. Si on ne les forme pas, ces employés se développent lentement connaissant tôt le plafonnement professionnel. Leur trajectoire est la suivante : ils entrent comme manœuvres5) et au fil du temps, ils se spécialisent sur un poste de travail ou une opération, généralement de faible complexité, ou encore, ils passent d’une unité de production à une autre devenant polyvalents, mais sur des petits travaux. Cette trajectoire typique des « bas niveaux de qualification » est bien connue dans les industries manufacturières et nous avons eu l’occasion de la documenter pour les industries dont il est question ici6) et pour les industries de la fabrication métallique industrielle.
L’effet progression-mobilité
L’effet sur la progression ou la mobilité professionnelle est aussi structurant à condition de prendre en compte les caractéristiques des employés à l’entrée d’un programme. En effet, si la majorité est plus polyvalente à la sortie d’un programme, nous pouvons penser que les tâches plus complexes, mieux rémunérées, le changement de poste ou d’emploi ou la promotion touchent davantage ceux qui détiennent déjà de l’expérience sur l’une ou l’autre des compétences du programme à l’entrée.
Par conséquent, il intéressant de constater que, dans cette industrie, le dispositif de qualification professionnelle d’Emploi-Québec permet d’agir là où il le faut et ce, à la satisfaction des employeurs qui ont grand besoin d’employés plus polyvalents et plus qualifiés – pour faire face à la concurrence des pays à bas coûts de production et aux avancées de la technologie – mais aussi à la satisfaction des employés qui autrement auraient du mal à progresser.
À partir des résultats de cette enquête, on peut émettre l’hypothèse qu’en milieu manufacturier, le dispositif agit comme un déclencheur et un accélérateur de développement professionnel et ce, pour les travailleurs faiblement qualifiés à l’embauche. Les chercheurs du CÉREQ, analysant les usages des certificats de qualification paritaires de la métallurgie (les CQPM sont comparables aux CQP octroyés via le PAMT par le CSMOFMI) ont constaté cet effet bien avant nous7). Quoiqu’il en soit, il y a là matière pour une étude plus approfondie.
Pour résumer sur les usages, disons que le dispositif de qualification professionnelle d’Emploi-Québec utilisé d’abord pour former une nouvelle main-d’œuvre l’est maintenant tout autant pour perfectionner une main-d’œuvre qui détient déjà de l’expérience sur les métiers visés par les programmes. Et par conséquent, de dispositif de qualification en début de carrière accompagnant l’insertion ou l’intégration professionnelle, il est aujourd’hui aussi, et tout autant, dispositif de qualification en cours de carrière accompagnant le développement professionnel.8) Et bientôt, si les comités sectoriels réussissent le virage reconnaissance-constat, il deviendra aussi dispositif de qualification en cours de carrière accompagnant la reconnaissance professionnelle.
Cette évolution est intéressante parce qu’elle inscrit le dispositif du réseau de l’emploi dans la mouvance internationale du développement des systèmes de certification à destination de la main-d’œuvre active. Toutefois, le virage reconnaissance-constat ne va pas sans risques. D’abord, consacrant la dissociation du couple formation-certification, il rend nécessaire le développement de procédures et d’outils d’évaluation plus formels et dès lors, il est plus difficile de demeurer au plus près du contexte du travail réel. C’est là un vrai défi pour les comités sectoriels. Seront-ils tentés, par la suite, d’introduire les outils d’évaluation des compétences développés pour les travailleurs sans emploi dans le PAMT comme outils de positionnement? Ce serait logique et de ce fait, tentant. Et cela faisant, le dispositif actuel perdrait-il en souplesse ce qu’il gagnerait en crédibilité?
Ce sont là autant de questions pour qui s’intéresse à l’ingénierie de la formation et à l’évaluation des compétences acquises en milieu de travail. En fait, le développement de la reconnaissance-constat offre un formidable terrain d’observation et d’analyse aux chercheurs d’ici, à l’instar de la VAE pour les chercheurs français. Et ce, d’autant, qu’il y a des comités sectoriels, qui s’inspirent de la VAE française, plus spécifiquement de l’approche plurimodale, pour développer leurs démarches et leurs outils de reconnaissance des compétences.
Notes
- Hart, Sylvie Ann, Enquête sur les clientèles, les usages et les effets du programme d’apprentissage en milieu de travail au sein des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine, Comité sectoriel de main-d’œuvre des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine, janvier 2010, http://www.solutionsrh.net/pdf/RAPPORT_ENQUETE_PAMT.pdf
- Voir l’article intitulé La validation des acquis professionnels, bilan des pratiques actuelles, enjeux pour les dispositifs futures, in Bref n. 185, CEREQ, avril 2002.
- CSMOFMI, Le processus de reconnaissance des compétences dans les industries de la fabrication métallique industrielle, document soumis à la CPMT, CSMOFMI, avril 2008.
- Idem.
- Ceux qui ont un diplôme de formation professionnelle entrent en apprentissage sur des fonctions de travail plus complexes.
- Hart, Sylvie Ann et Jean-Denis Careau, Enquête sur les emplois des industries de la transformation du bois d’apparence en Estrie, étude réalisée pour le Créneau de la Transformation du bois d’apparence de l’Estrie, Service intégré du bois, Sherbrooke, septembre 2008 et Sylvie Ann Hart, Carte des emplois de l’industrie de la tôle forte et de la charpente métallique, CSMOFMI, Montréal, novembre 2002.
- Personnaz, Elsa et Patrick Veneau, Former pour adapter et recruter – Usages des certificats de qualification paritaires dans la métallurgie, Céreq, Documents, numéro 162, avril 2002, Marseille, page 51.
- Le dispositif de qualification des branches professionnelles en France a connu le même développement. Voir Sylvie Ann Hart, « FRANCE CQP VAE » dans un ouvrage réalisé en collaboration avec Frédéric Lesemann et Michel Lejeune, Inventaire international et documentation des dispositifs nationaux de qualification professionnelle (France, États-Unis, Espagne, Italie, Portugal, Suisse et Mexique), INRS Urbanisation, culture et société, mars 2005
Extrait
Entre le Régime de qualification né en 1993 sous l’égide de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre et le Programme d’apprentissage en milieu de travail mis sur pied par la Commission des partenaires du marché du travail en 2001, près de vingt ans se sont écoulés.