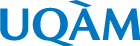Le cadre national de qualifications de la France
En 2008, le Parlement européen adopte le Cadre européen des certifications (CEC) pour deux objectifs essentiellement : promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre sur le territoire européen et encourager l’éducation et la formation tout au long de la vie. C’est dans ce contexte, que la France a entrepris d’arrimer son propre cadre national des certifications avec le CEC.
Le cadre national de qualification français est constitué par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). C’est un cadre national mais il aussi universel puisqu’il rassemble les certifications provenant, dirions-nous ici, de la formation professionnelle, technique, universitaire et de la formation en milieu de travail, que celles-ci soient acquises par la formation ou la reconnaissance de l’expérience. Il s’agit donc d’un cadre englobant qui exclut, cependant, les certifications de la formation générale1). Le RNCP est opéré par une instance multipartite, la Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP) sur laquelle siègent, entre autres, les ministères certificateurs2), les partenaires sociaux, des chambres de commerce et des représentants régionaux3).
Pour bien comprendre le rôle et la portée du RNCP, il faut savoir (1) que ce répertoire ne comprend que des certifications d’État et des certifications reconnues par l’État, (2) qu’il existe en France de nombreux organismes qui ont le pouvoir de décerner des certifications4) et (3) qu’ils ont avantage à les faire reconnaître par l’État puisque ce statut leur permet d’avoir accès à du financement. Ce dispositif et d’autres donnent à la France un système national, unitaire et puissamment centralisé en ce qui a trait au contenu des enseignements et aux principes de certification. Une prouesse considérant qu’il existe, dans ce pays, plus de 15 000 certifications.
Dans le RNCP, les certifications sont classées par niveaux et pour ce, les français utilisent une grille qui remonte aux années 60, dont il existe deux versions. La première, datant de 1967 est fondée sur la durée des études et elle aujourd’hui tombée en désuétude. La seconde, dite Classification interministérielle des certifications professionnelles, fut créée en 1969 pour classer les certifications, non pas selon la durée des études, mais plutôt en fonction du niveau d’autonomie et de responsabilité dans une organisation de travail. C’est cette grille qui fait de la France un des premiers pays à avoir expérimenté un dispositif qui s’apparente aux cadres nationaux contemporains5). La Classification interministérielle se compose de cinq niveaux. Dans le schéma suivant, nous voyons que la correspondance entre la grille française et le Cadre européen se fait difficilement et ce, particulièrement aux plus hauts et aux plus bas niveaux.
Correspondance de la Classification interministérielle des certifications professionnelles avec la grille du Cadre européen des certifications (CEC)

Même si la grille de 1969 exprime des débouchés en termes d’emploi, elle demeure « fortement corrélée aux cursus éducatifs de l’éducation ». En outre, réalisée dans les années 70, « elle ne reflète plus les débouchés ni les exigences en termes d’emploi liées à chaque niveau de qualification ». Pour ces raisons, la France travaille actuellement à la conception d’une nouvelle nomenclature dont les niveaux seront plus compatibles avec le CEC (CNCP, 2010 : 24).
Enfin, les certifications enregistrées au RNCP doivent être fondées sur un référentiel de compétences. C’est même là une condition sine qua non pour y figurer. Sur ce plan, le cadre français est conforme à l’esprit des cadres nationaux contemporains. Et cela, il le doit à l’obligation légale de la validation des acquis de l’expérience. En fait, le RNCP et la CNCP ont été créés en 2002, dans le cadre de la Loi de modernisation sociale instituant la Validation des acquis de l’expérience (chapitre II, section 1, articles 133 à 146). La VAE est un droit individuel en France, pour toutes les personnes engagées dans la vie active. Sans entrer dans les détails, disons que cette loi a obligé les organismes certificateurs, y compris les ministères, à réécrire les référentiels en termes de compétences pour que les certifications soient accessibles par la VAE. Et si aujourd’hui, le RNCP ne compte que 6 920 certifications (chiffre de 2012) c’est en raison de la difficulté, voire réticence, des établissements de l’enseignement supérieur, dont les universités, à établir un référentiel de compétences pour leurs diplômes.
Le RNCP décrit les formations à suivre à chaque niveau de la grille pour accéder au métier, qui peut s’acquérir par la formation en institution, par apprentissage ou par VAE. Tout débute par le Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) qui donne un premier accès au métier. Il peut être suivi de courtes spécialisations nommées Mention complémentaire (MC). Le Brevet professionnel (BP) constitue une formation supplémentaire permettant au coiffeur d’ouvrir son propre salon; celui-ci devant en outre avoir au moins deux ans d’expérience comme coiffeur pour le faire. Finalement, au niveau supérieur (III), le Brevet de maîtrise (BM) permet aux détenteurs de BP d’avoir une formation en gestion, comptabilité et gestion du personnel. Il y a aussi un Certificat de qualification professionnelle (CQP) octroyé par la branche professionnelle du métier qui ne reçoit pas de niveau6).
Les certifications de la coiffure en France
| Certification | Grille classification (FR) | Cadre européen |
| CAP – CoiffureMC5 – Coloriste PermanentisteMC5 – Styliste-Visagiste | V | 3 |
| BP – CoiffureBP – Coiffure option styliste-visagisteConseillère en image personnelle et communication | IV | 4 |
| Coiffeur (BM)Un des meilleurs ouvriers de France (diplôme d’État) Groupe métiers de la coiffure et de l’esthétique, spécialité coiffure-création | III | 5 |
| CPQ – Responsable de salon de coiffure | – | – |
Le RNCP décrit les référentiels d’emploi pour chacune de ses certifications. La complexité des tâches croît avec la grille. Ainsi, un détenteur de CAP doit être en mesure de réaliser des coupes de cheveux, de réaliser des techniques de mise en forme ou encore de conseiller et vendre des produits. Le titulaire du BP doit concevoir des coiffures personnalisées, concevoir et réaliser des coiffures évènementielles, mais aussi assurer la gestion administrative et financière de l’entreprise et accompagner les coiffeurs. Au niveau III, il s’agit d’être apte à diriger l’entreprise en termes de commercialisation, gestion économique et financière, gestion d’équipe et gestion des ressources humaines. Le coiffeur détenant un BM peut devenir formateur et jouer un rôle d’accompagnateur auprès des autres coiffeurs.
Pour chaque certification, le RNCP en décrit les composantes qui ne se limitent pas à des compétences liées à la coiffure. Selon les niveaux, les compétences et connaissances incluent des savoirs relatifs à la communication, le français et l’histoire, les mathématiques, une langue vivante étrangère, la gestion d’entreprise ou les sciences et technologies.
Malgré une grande transparence du parcours possible dans le domaine de la coiffure, il n’y a pas, contrairement au système australien ou écossais une possibilité de cheminement modulaire et flexible. Le parcours demeure linéaire, d’une certification à l’autre, ce qui ne se fait pas par cumul de modules ou de crédits.
Le cadre national de certification français est un cadre d’information (Raffe, 2013), c’est-à-dire que son principal objectif est d’assurer une transparence dans le processus de certification. Il joue également un important rôle régulateur. En effet, la place de choix qu’il accorde à la reconnaissance de l’expérience a contribué au succès des procédures VAE en France.
Des limites exigent toutefois des modifications du cadre. Un enjeu clé est la classification en cinq niveaux qui ne permet pas de tenir compte des extrêmes de qualification. Par exemple, les plus bas niveaux, reconnus ailleurs en Europe, ne le sont pas en France. C’est d’ailleurs pour contrer une telle limite que la CNCP travaille actuellement au développement d’une grille à 8 niveaux.
Autre limite, c’est que le cadre se concentre sur les titres et les diplômes. La modularité et l’acquisition de compétences par crédits ou par unités d’apprentissage ne sont pas possibles.
Malgré tout, le modèle français reste un bel exemple. Le travail continu de transformation et d’amélioration qu’il a connu au fil des années amène le Cedefop (2012) à souligner que peu importe les qualités d’un système national de certifications, celui-ci doit être constamment renouvelé afin de rester pertinent et d’actualité.
Notes
- Plus précisément les diplômes de la formation générale, telles que le Brevet des collèges et les Bacs généraux, équivalents du DES et des DEC de la filière pré-universitaire québécoise.
- En France, plusieurs ministères partagent la responsabilité de la formation institutionnelle : l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur et la recherche, l’Emploi, l’Agriculture, la Santé et les affaires sociales, la Défense, la Culture, les Affaires maritimes, la Jeunesse et les sports.
- La Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) est une commission interministérielle, interprofessionnelle et interinstitutionnelle. Elle est composée de seize représentants ministériels, de dix partenaires sociaux, de trois représentants élus des chambres consulaires (organimes publics ou para-publics auxquels des entreprises adhèrent, ex. chambres de commerce), de trois représentants élus des régions et de douze personnes qualifiées. Ces commissaires sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable. (Wikipédia, Commission nationale de la certification professionnelle).
- Les organismes certificateurs sont les suivants et la liste n’est pas exhaustive : l’État via les ministères chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi, de l’Agriculture, de la Jeunesse, de la Santé et des Sports, des Affaires sociales et de la Culture; les partenaires sociaux via les branches professionnelles, les établissements publiques ou privés en leur nom propre, les établissements consulaires, c’est-à-dire relevant des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres d’agriculture, etc.
- Pour Bouder et Kirsch (2007), la Classification interministérielle des certifications professionnelles constitue un prototype méconnu des systèmes nationaux de certification qui se développent en Europe depuis plus d’une décennie.
- Les CQP des branches professionnelles correspondent aux CQP conçus par les comités sectoriels et décernés par Emploi-Québec. Dans le RNCP, ils ne sont pas classés par niveaux. Il y a derrière cette spécificité des enjeux complexes.
Références
Bouder, A., & Kirsch, J.-L. (2007). The French Vocational Education and Training System: like an unrecognised prototype?. European Journal of Education, 42(4).
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (2013). Analysis and overview of NQF developments in European countries, Annual Report 2012. CEDEFOP, Working paper n. 17.
CNCP (2010). Référencement du cadre national de certification français vers le cadre européen de certification pour la formation tout au long de la vie. France, Commission nationale de la certification professionnelle, octobre.
Raffe, David (2013). What is the evidence for the impact of National Qualifications Frameworks? Comparative Education, 49:2, 143-162.
En savoir plus
Sur la Commission Nationale de la Certification Professionnelle et le Répertoire National des certifications professionnelles, consultez le site de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Sur tout le processus d’arrimage du cadre français au cadre européen, consultez cet document qui, en plus, fait une excellente synthèse du système français : Référencement du cadre national de certification français vers le cadre européen de certification pour la formation tout au long de la vie. France, Commission nationale de la certification professionnelle, octobre 2010.

Extrait
Le Cadre français est accompagné d’une instance multipartite, la Commission Nationale de la Certification Professionnelle, qui offre aux organismes autres que l’État, la possibilité de faire reconnaître leurs certifications nationalement. En d’autres termes, dans ce pays, l’Éducation Nationale (ministère de l’éducation français) doit partager ce privilège avec d’autres acteurs.